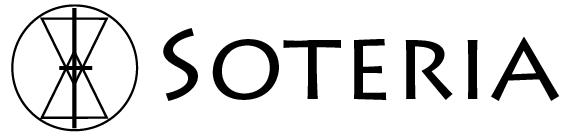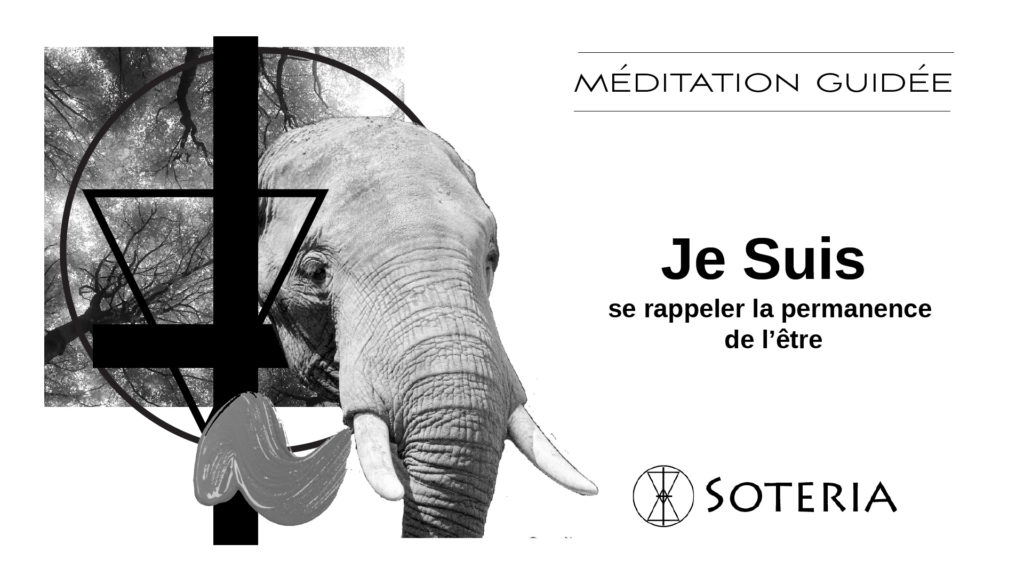« Fuis, fais silence, repose-toi ! »
Un vademecum pour nos temps troublés
« Fuge, tace, quiesce ! » — « Fuis, tais-toi, repose-toi ! » : tels sont les enseignements, les exercices qui ont été recommandés au début de notre ère à Arsène le Grand, connu également sous le nom d’Arsène de Scété (Sketis). Arsène est un saint de l’Église Orthodoxe qui a vécu au 4e siècle et est renommé comme l’un des principaux ermites chrétiens. Après la dévastation de sa ville en 434, il s’était retiré dans le désert au sud du Caire. Selon la légende, dans cette vie solitaire, il entendit une voix qui lui disait : « Arsène, fuis, tais-toi, repose-toi dans le recueillement : ce sont là les racines de l’impeccabilité ».
Quelques soient nos convictions religieuses ou spirituelles ou notre absence de croyances dans ces domaines, Il y a là un message utile à chacun d’entre nous : ce triple conseil, donné au IVᵉ siècle à Arsène le Grand, résonne avec une force singulière dans notre modernité saturée de sollicitations, marquée par une grande agitation, une profonde confusion et une accélération constante.
Loin d’être une fuite du monde, il propose une autre manière d’y habiter : une forme de résistance douce, une ascèse intérieure pour retrouver la mesure, le discernement et la paix. Ces trois impératifs — fuir, se taire, se reposer — peuvent être lus comme autant d’exercices spirituels et philosophiques qui réapprennent à l’homme à exister autrement.
Fuge — Fuis !
Fuir, ce n’est pas renoncer : c’est choisir où poser son attention. Dans un monde qui érige la visibilité et la connexion permanente en vertu, la fuite devient un acte de liberté. Fuir, c’est s’extraire de la tyrannie de l’instantané, des flux d’informations et des injonctions à la performance. C’est retrouver un espace intérieur où la pensée peut se reformer sans être happée par le vacarme du monde. Car le désert d’Arsène n’est pas nécessairement un lieu géographique : il peut être un espace intérieur, un temps de retrait, une pratique de sobriété numérique, une marche solitaire, une coupure volontaire d’avec la cacophonie ambiante. Cette fuite-là n’est pas désertion, mais repositionnement : elle est la condition pour retrouver une juste présence au monde, une présence choisie plutôt que subie.Il ne s’agit donc pas de se retirer dans une grotte, mais de créer des zones d’insoumission qui peuvent prendre diverse formes: éteindre les écrans, se soustraire à la comparaison sociale, refuser le bavardage numérique, …
Fuir, aujourd’hui, c’est sauvegarder sa capacité d’attention, cet organe spirituel si rare et si précieux que Simone Weil appelait « la forme la plus pure de la générosité ».
Tace — Fais silence !
Le silence est aujourd’hui un luxe rare, presque subversif. Là où tout incite à parler, commenter, réagir, s’exprimer sans fin, se taire devient une forme de résistance. Le silence n’est pas le mutisme, ni la soumission : il est la matrice du discernement et la condition d’une parole juste. Nous vivons à une époque où chacun s’exprime sans cesse, mais où peu écoutent réellement. Se taire, c’est donc cesser d’occuper l’espace sonore pour redevenir disponible au réel, à l’autre, à soi-même..
Le silence n’est pas absence, mais plénitude d’écoute. Il ouvre l’espace à l’altérité, permet à l’autre — humain, naturel, divin ou symbolique — d’exister en nous sans être aussitôt recouvert par le bruit de nos opinions. Apprendre à se taire, c’est apprendre à entendre ce qui, d’ordinaire, ne peut se dire : la nuance, l’émotion, la vérité fragile qui échappe aux slogans et aux certitudes.
Le silence n’est pas vide : il est un milieu fécond où les pensées s’ordonnent, où la vérité peut apparaître sans être noyée dans le commentaire. Dans le silence, la pensée s’approfondit, la parole se décante et retrouve son poids.
Le silence est une méthode : il suspend le jugement, dissout les automatismes, permet d’accueillir ce qui est.
Le silence est un acte de rupture, sociologiquement : il oppose à la logorrhée sociale un retrait signifiant, un refus de participer à la cacophonie. Faire silence, c’est retrouver la dignité du langage et la profondeur de l’écoute.
Quiesce — Repose-toi !
Ce dernier impératif n’est pas une invitation à la paresse, mais à la pacification. Le repos véritable n’est pas l’oisiveté distraite, mais la réconciliation intérieure après la fuite et le silence. Reposer son esprit, c’est lui permettre de se régénérer, de retrouver la clarté et la justesse de son mouvement. Dans un monde qui glorifie la productivité et où tout s’évalue en rendement et performance, le repos devient une forme de résistance éthique et spirituelle : il réaffirme que l’être précède le faire. Se reposer, c’est consentir à la lenteur, redécouvrir la gratitude, accueillir le réel sans le forcer, développer l’art de la réceptivité. C’est, pour reprendre les mots de Pascal, « demeurer tranquille dans une chambre » et y trouver la paix qu’aucune conquête extérieure ne peut offrir.
Ainsi, fuir, se taire, se reposer forment une triple voie de salut pour notre modernité épuisée. Ce triptyque, loin d’être une morale de retrait, dessine une écologie de l’âme et de la pensée. Dans un temps où l’humanité s’étourdit de sa propre agitation, retrouver le geste d’Arsène, c’est renouer avec la part la plus libre et la plus lucide de soi-même. Fuir pour se dégager, se taire pour s’entendre, se reposer pour renaître : trois attitudes simples, presque antiques, mais d’une actualité brûlante. Car c’est souvent dans le retrait que se prépare la vraie présence, dans le silence que se forge la parole juste, et dans le repos que mûrit l’action qui change le monde.